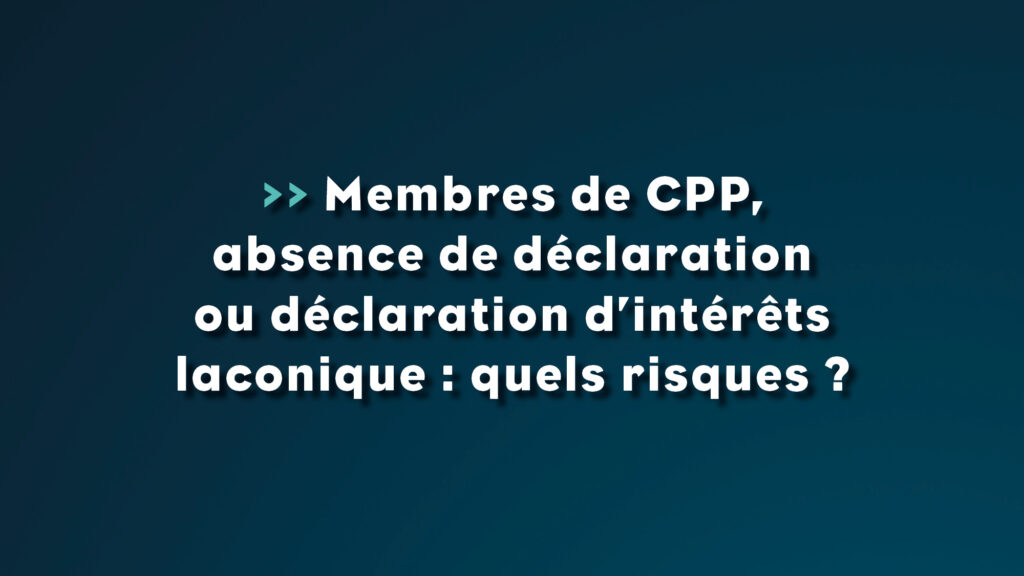La garantie de transparence et d’intégrité des avis rendus par les Comités de Protection des Personnes (CPP) implique que leurs membres se conforment à leur obligation de déclaration publique d’intérêts.
Le défaut de déclaration peut être, pour les intéressés, source de sanctions, mais peut surtout interroger sur la légalité des avis rendus à l’issue de délibérations auxquelles auraient participé des membres défaillants.
1. Les membres des CPP doivent-ils établir une déclaration publique d’intérêts ?
Un lecteur pressé, s’intéressant de longue date au fonctionnement des CPP, pourrait considérer que les membres des CPP n’ont plus d’obligation de déclarer leurs liens d’intérêts.
La lecture de l’article L. 1123-3 du code de la santé publique (CSP) dans sa version actuelle ne contient plus son ancien alinéa 2 qui était rédigé en ces termes :
« Les membres du comité adressent au directeur général de l’agence régionale de santé, à l’occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les promoteurs et les investigateurs de recherches. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. ».
La disparition de ces dispositions législatives pourrait laisser à penser que cette obligation de déclaration n’incombe plus aux membres des CPP.
Ce sentiment pourrait être corroboré par la lecture de l’article L. 1123-1-1 du CSP (juste au-dessus) qui concerne le fonctionnement de la Commission Nationale des Recherches Impliquant la Personne Humaine (CNIRPH) et prévoit spécifiquement que ses membres doivent établir et actualiser une déclaration d’intérêts.
Mais, il n’en est rien !
Les membres de CPP ont bien l’obligation d’établir une déclaration publique d’intérêts, mais plus en application de l’alinéa 2 de l’article L. 1123-3 du CSP, mais bien du I de l’article L. 1451-1 du CSP.
« Article L. 1451-1
I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, (…) du présent code, (…)sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d’établir une déclaration d’intérêts. »
Cette refonte législative a été opérée il y a près de 14 ans par la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (JORF 30 décembre 2011).
2. Quel est le contenu de cette déclaration publique d’intérêts ?
L’article L. 1451-1 du CSP précise que cette déclaration mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités entrent dans le champ de compétence de l’organe au sein duquel il siège, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.
Concrètement tout membre de CPP doit déclarer les intérêts qu’il peut avoir ou qu’il a pu avoir au cours des 5 dernières années avec des promoteurs et, de manière plus anecdotique, avec des investigateurs.
Lorsque l’on consulte les déclarations publiques sur le site dédié (Ministère des Solidarités et de la Santé – Consultation des déclarations publiques d’intérêts) nous pouvons constater que les questionnaires peuvent prêter à confusion ou ne sont pas adaptés à toutes les professions.
Ce formulaire est parfaitement adapté à un agent public hospitalier qui mentionnera qu’il exerce son activité principale au sein de tel établissement (et pour lequel il se trouvera être en conflit d’intérêts potentiel lorsque celui-ci se porte promoteur d’une étude soumise à son CPP) et précisera qu’à titre secondaire (ou accessoire) il intervient comme consultant pour tel laboratoire pharmaceutique ou fabricant de dispositifs médicaux.
Par contre, tel n’est pas le cas pour certains professionnels, notamment des avocats ou des consultants. Lorsqu’au moment de leur prise de fonction, ils remplissent leur déclaration, ils sont invités à renseigner en premier lieu leur activité principale. Ils vont donc indiquer qu’ils sont avocats ou consultants.
A ce stade, il ne leur est pas demandé si, dans le cadre de leur activité principale, ils ont des intérêts à déclarer.
Lorsque l’on poursuit la lecture d’une déclaration, nous arrivons à la seconde rubrique « Activité(s) exercée(s) à titre secondaire » pour laquelle certains professionnels ne se sentiront pas concernés, car n’estimant pas développer de telles activités secondaires.
Pourtant l’analyse de ces sous-rubriques mériterait que ces professionnels s’y intéressent.
En effet, le 2.2 indique « Activité(s) de consultant, de conseil ou d’expertise exercée(s) auprès d’un organisme public ou privé entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme /des organismes ou de l’instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration. »
Ainsi, une activité de conseil auprès d’un promoteur potentiel, c’est-à-dire d’une entreprise intervenant dans le secteur de la santé et susceptible de se porter promoteur d’une recherche clinique, devrait être considéré comme un lien d’intérêt nécessitant d’être déclaré.
L’absence de déclaration d’un tel lien ne permet pas de respecter les dispositions de l’article L. 1451-1 du CSP.
3. Quelles conséquences de l’absence ou de fausses déclarations par les membres de CPP ?
Le fait de s’abstenir d’établir cette déclaration d’intérêt ou d’établir une fausse déclaration, en omettant certaines informations, est clairement sanctionné par les dispositions de l’article L. 1454-2 du CSP.
« Est puni de 30 000 euros d’amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 1451-1 et à l’article L. 1452-3 d’omettre sciemment, dans les conditions fixées par ce même article, d’établir ou de modifier une déclaration d’intérêts afin d’actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration. »
Au-delà des sanctions individuelles susceptibles de toucher les membres de CPP, le défaut de déclaration ou l’établissement de déclaration laconique pourraient engager la responsabilité des personnes en charge de veiller au bon fonctionnement des CPP et de leurs membres.
L’article L. 1451-4 du CSP rappelle que chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d’elle, au respect des obligations de déclaration des liens d’intérêts.
Concernant les membres des CPP, nous pouvons considérer que cette autorité est le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) compétente qui a procédé à leur désignation en application de l’article L.1123-1 du CSP.
Il revient donc aux directeurs généraux des ARS concernés de vérifier et faire respecter cette obligation de déclaration publique d’intérêts, sous peine de voir leur responsabilité engagée.
Enfin, le non-respect de cette obligation de transparence peut entrainer de lourdes conséquences sur les avis rendus par les CPP.
Peut-on considérer que toutes les garanties de légalité d’une décision sont réunies lorsque certains membres du CPP, siégeant lors de délibération conduisant à cet avis, susceptible de faire grief, ne se sont pas ou mal acquitté de leurs obligations déclaratives ?
La réponse est bien évidemment, non !
Une telle insécurité juridique autour des avis ne devrait pas être tolérée par les présidents de CPP. En leur qualité de garants de l’efficience des travaux de leur comité, ils ne devraient pas accepter que des membres non à jour de leurs obligations déclaratives ou à l’origine de déclarations manifestement incomplètes participent à des délibérations conduisant à rendre des avis susceptibles d’être annulés du fait de leur illégalité.
Le respect de l’obligation de réaliser et remplir correctement une telle déclaration publique d’intérêt lors de leur désignation (sans oublier de l’actualiser régulièrement) doit être appréhendé avec le plus grand sérieux par les membres des CPP.
4. Et le secret professionnel de certains membres de CPP, n’est-ce pas un totem d’immunité ?
Comme l’avait justement rappelé la DGS dans une circulaire du 23 mai 2008, aucune règle professionnelle ne peut faire obstacle à cette obligation de transparence qui est prévue par une disposition légale spécifique.
L’évocation de l’adage « speciala generalibus derogant » (« les lois spéciales dérogent aux lois générales ») est adaptée à l’obligation de transparence souhaitée par le législateur à l’égard de toute personne participant aux travaux d’instances d’évaluation tel que les CPP, qui ne pourrait être mis à défaut par des principes généraux gouvernant l’exercice de certaines professions.
Une nuance mérite malgré tout d’être apportée aux dispositions de cette circulaire sur le fondement du secret professionnel des avocats. Il ne s’agit pas d’un principe contenu dans un code déontologique à valeur réglementaire, mais bien d’une disposition législative, issue de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Article 66-5
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle « , les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
Par la suite, c’est effectivement le Règlement Intérieur National (RIN) qui précise, en son article 2.2, que le secret professionnel couvre l’identité des clients de l’avocat.
La violation de cette obligation de secret par la révélation de l’identité de l’un ou de ses clients est sanctionnée par l’article 226-13 du code pénal.
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Ainsi, lorsqu’un professionnel soumis à une obligation de secret souhaite répondre à l’appel à candidatures lancé par un directeur général d’ARS afin de recruter des membres de CPP, il devrait avoir à l’esprit que de telles fonctions impliquent de devoir rendre public des liens d’intérêts qu’il entretient, ou qu’il a pu entretenir au cours des 5 dernières années, avec des clients susceptibles d’être promoteurs de recherches cliniques.
S’il pense être concerné par une telle divulgation, ses obligations déontologiques et son éthique devraient le conduire à s’abstenir à répondre à cet appel à candidatures !
⇒ Thomas ROCHE, avocat associé